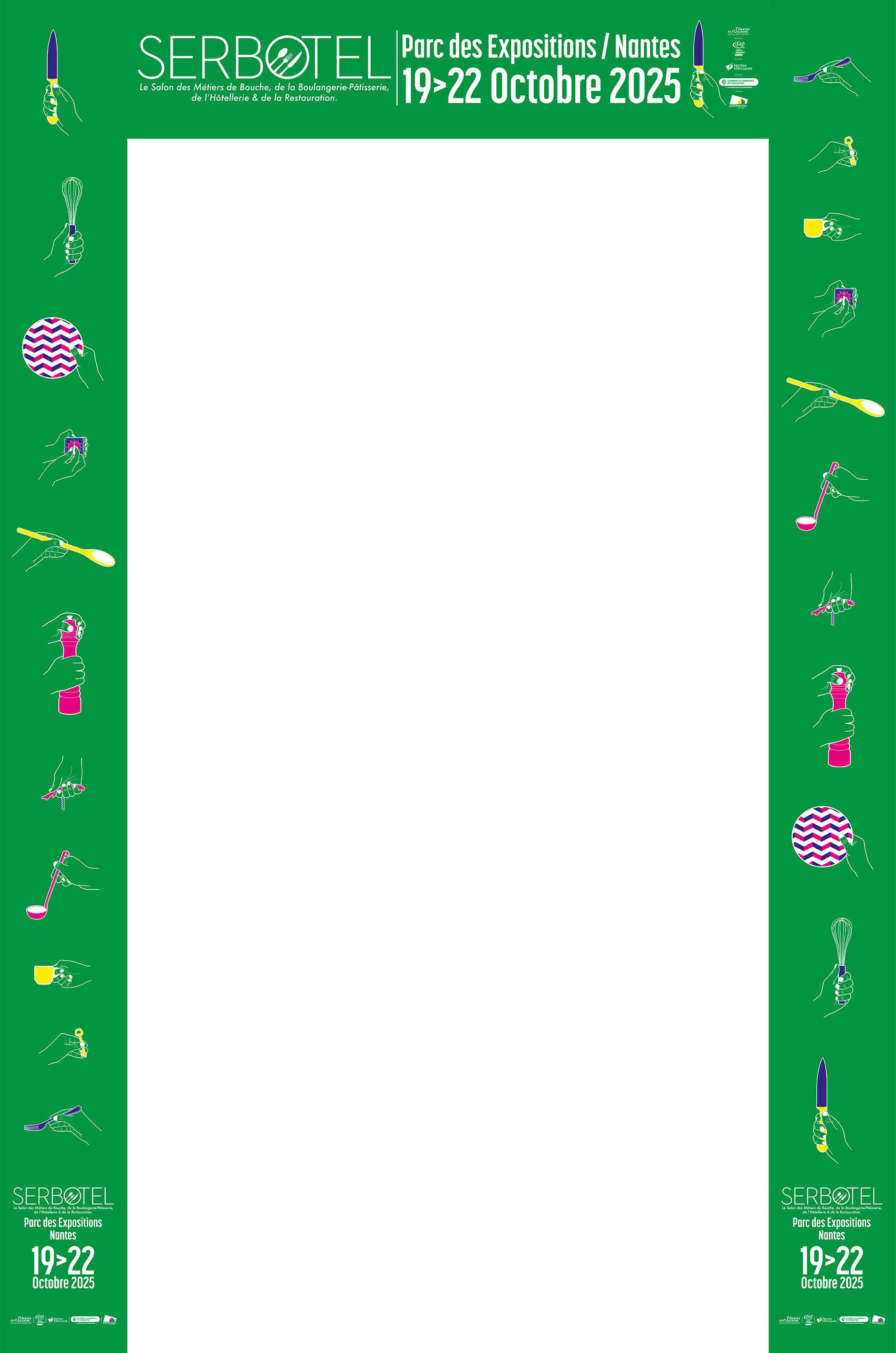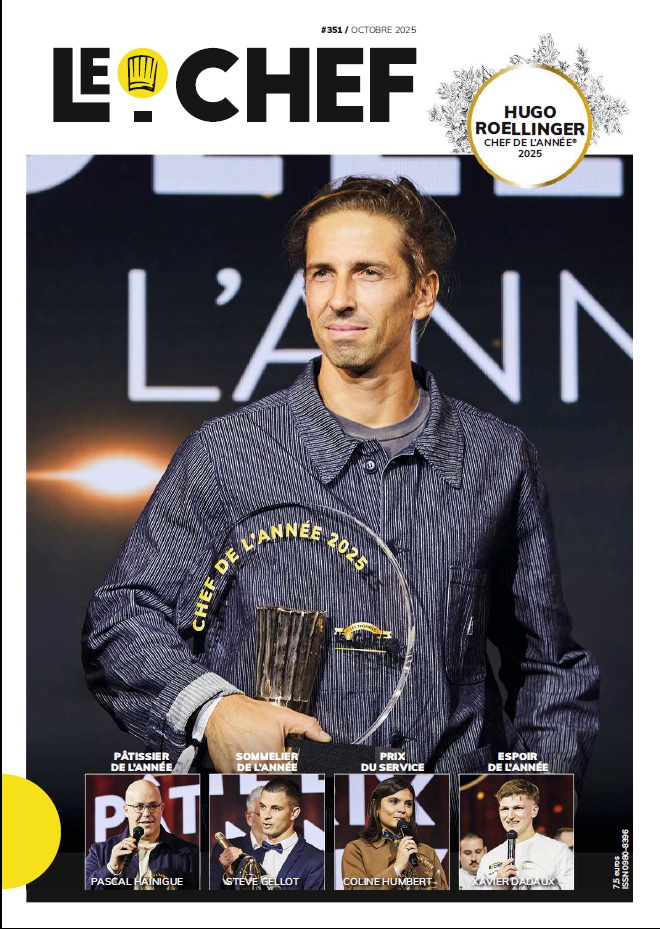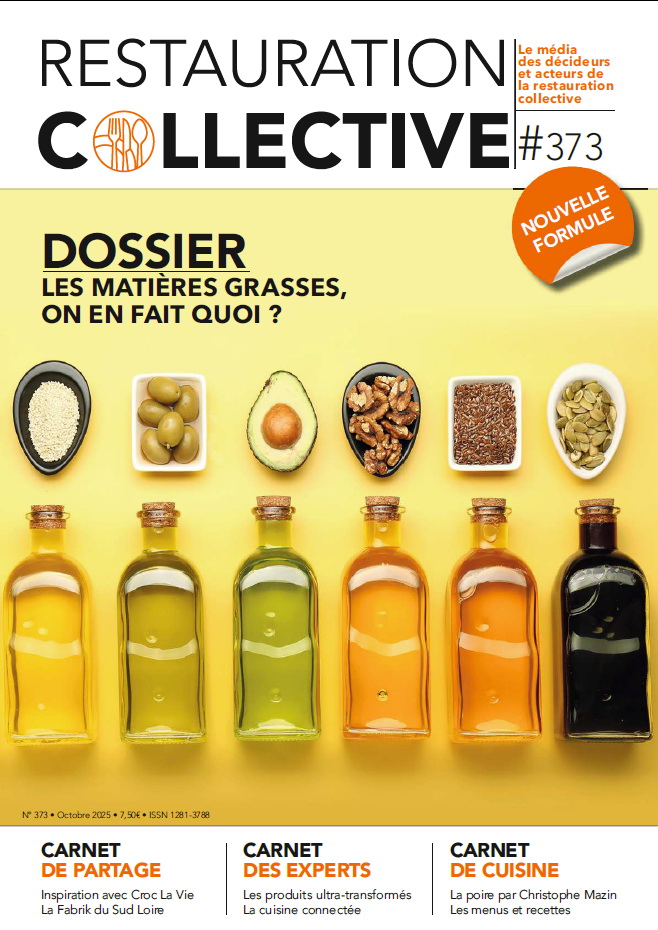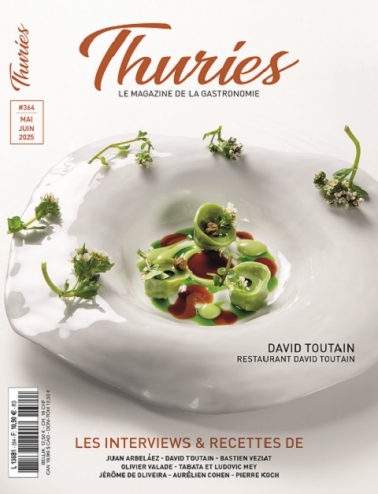Si la restauration commerciale a connu, encore en 2001, une progression de son chiffre d'affaires, celle-ci a surtout touché la restauration de chaîne. + 6 % d'augmentation en restauration de chaîne pour + 3 % de la totalité de la restauration commerciale. Il ne semble pas qu'en 2002 la restauration enregistre une baisse de ses chiffres. Au global, la restauration connaît une progression constante depuis de nombreuses années (à part 1996), même si cette progression fut assez modeste à certaines époques et si elle est très différemment répartie selon les types de restauration.
La France accusait un retard assez net dans la constitution de son secteur structuré, c'est-à-dire les chaînes, par rapport aux pays d'Europe du Nord. Elle a entamé depuis huit ans une accélération de sa mutation en augmentant son parc d'établissement de chaînes au détriment du secteur indépendant. Mais il ne faut pas percevoir le secteur des chaînes comme uniquement composé de grands groupes financiers. De nombreuses chaînes n'ont qu'une taille modeste et ont été lancées par des indépendants.
Sans constituer un raz-de-marée remettant la totalité des établissements indépendants en question, le pays a connu une modification de la demande de consommation en restauration. Evolution sensible de la part de la clientèle familiale et de la part de la clientèle des 18-35 ans. Ces clientèles remettaient en question le modèle traditionnel du restaurant, en demandant des prestations allégées, des prix maîtrisés, dans un décor plus festif et ludique, avec une ambiance informelle, où la thématisation était un support d'animation. Cette offre allégée et informelle était cohérente avec les comportements de grignotage de plus en plus présents. Dans un monde où le spectacle est devenu essentiel et presque permanent, le restaurant se devait d'y participer. La restauration rapide et sa version française, la sandwicherie, en perpétuelle progression, donnaient le ton à une nouvelle approche de la restauration.
Cette onde de choc a touché la restauration assise à ticket moyen plus élevé. La restauration tendance ou de mode a commencé à essaimer des établissements en région parisienne, puis dans les grandes villes, pour s'établir aujourd'hui dans des villes moyennes.
Parallèlement, on notait une bonne résistance de la partie la plus dynamique de la restauration indépendante. Plusieurs établissements indépendants adoptaient des styles, des décors et des cartes de restauration tendance et de restaurants à thème. D'autres se renforçaient dans leurs ancrages gastronomiques tout en allégeant le prix, le formalisme du service et la prétention des cartes.
Cette restauration traditionnelle mutante se mettait à créer une nouvelle restauration de qualité destinée aux masses et à savoir maîtriser les plus grandes quantités de couverts. Plusieurs indépendants montraient ainsi que le «bien faire» pouvait être synonyme de grandes quantités. Aujourd'hui, le paysage de la restauration reste scindé en deux, d'un côté les établissements où priment la cuisine et les produits et d'un autre côté les établissements où la salle et l'ambiance bénéficient de l'attention prioritaire de leurs propriétaires.
La question est de savoir, pour évaluer la résistance de la restauration indépendante et traditionnelle et le maintien de sa part de marché, comment les jeunes cuisiniers vont intégrer des éléments de la restauration de mode, autant en décors qu'en recettes.
Après une décennie de restauration «tendance», on doit constater que si celle-ci progresse au global, cette avancée s'effectue avec une forte «mortalité» de ses établissements. Les faibles investissements en matériel et en savoir-faire dans la cuisine au détriment de la salle donnent une image de médiocre rapport qualité/prix de ces établissements. Ceux qui se maintiennent sur plus longue durée sont ceux dont le thème est fort et porteur et dont les prix restent attractifs.
Cette restauration contemporaine révèle le poids des thèmes dans l'attente de la clientèle. Elle montre aussi quel est le niveau d'attente d'exotisme de la clientèle française comme de la clientèle étrangère. Enfin, elle a mis en lumière l'importance de la taille critique, c'est-à-dire du niveau élevé de couverts à servir pour qu'un restaurant reste rentable en pratiquant un ticket moyen modeste ou attractif.
Cette restauration de tendance ne semble pas non plus être un phénomène passager et parisien puisqu'elle a pris pied en province, se taillant des succès dans des villes de moins de 100 000 habitants.
La restauration française est en cours de régler son problème de modernisation de l'offre aussi bien sous l'aspect cuisine tendance que sous l'aspect cuisine néo- gastronomique. En revanche, elle peine très nettement à résoudre son problème croissant de réorganisation et de mutation de ses moyens de fabrication. Avec une progression vertigineuse du coût global du travail salarié en France durant ces vingt dernières années, la restauration s'est énormément fragilisée en restant trop consommatrice de main-d'oeuvre. L'arrivée de la législation sur les 35 heures a porté un coup de grâce à toutes ses tentatives d'évitement. Pour garder une méthode de fabrication traditionnelle, la restauration a longtemps triché sur ses coûts réels de main-d'oeuvre en ne payant pas la totalité des heures travaillées. Mais ces pratiques commencent à voler en éclats devant l'écart de temps de travail et de rémunération entre les salariés de la restauration et ceux d'autres secteurs économiques. Les 35 heures se répercutent autant sur les coûts de main-d'oeuvre que sur les mentalités. La restauration commerciale n'arrive plus à attirer du personnel et à le fidéliser.
Fidéliser le personnel apparaît comme un combat perdu d'avance du fait de la trop faible rémunération de l'heure travaillée existant en restauration. La restauration doit opérer sa mutation en devenant une activité employant moins de main-d'oeuvre en fonction de son chiffre d'affaires. A 39 heures par semaine, et encore plus à 35 heures, un restaurant, pour être rentable, rémunérer son capital et ses dirigeants et payer ses investissements, doit réaliser un chiffre d'affaires de 135 000 euros par salarié au moins (y compris ses patrons). Sinon, les propriétaires se condamnent à ne pas se rémunérer, ou à faire travailler une partie du personnel partiellement gratuitement.
C'est donc une révolution industrielle à laquelle doit se contraindre la restauration, qui, comme toute révolution industrielle, est basée sur une forte augmentation de la productivité. Toutes les augmentations de productivité, quel que soit le secteur, s'opèrent à partir d'une réorganisation du travail basée sur l'amélioration du matériel. Et c'est là qu'entrent en jeu les industriels de matériel et les installateurs. Ils sont les vecteurs de cette nécessaire amélioration de productivité en recueillant et en diffusant toutes les expériences d'amélioration de l'efficacité des cuisines et des cuisiniers. L'automatisation de l'épluchage et du tranchage, l'avènement du four mixte ont apporté des avancées dans les temps de fabrication. Mais cela est largement insuffisant au regard du renchérissement du coût de la main-d'oeuvre. Le sous-vide qui devait apporter des facilités de fabrication n'a pas été appliqué de façon massive. Dans le même ordre d'idées, la cuisine différée n'a pas repris une place suffisante dans la restauration traditionnelle. Même dans la cuisine minute faite devant le client, des solutions de diminution des pertes de temps par suppression des déplacements et des gestes inutiles ont été trouvées. Aidées en cela par des mises en place judicieuses de matériels de préparation. Mais ces solutions restent confinées dans quelques établissements. La solution se trouve davantage dans cette approche de méthodes industrielles que dans l'espérance un peu naïve en des baisses de taxes et de charges sociales. Tout au long de l'histoire des économies développées, la relance de secteurs en difficulté a été réussie par des réponses techniques adaptées et novatrices à des défis. Aux cuisiniers, industriels et installateurs à relever celui de la cuisine, qui est de taille.