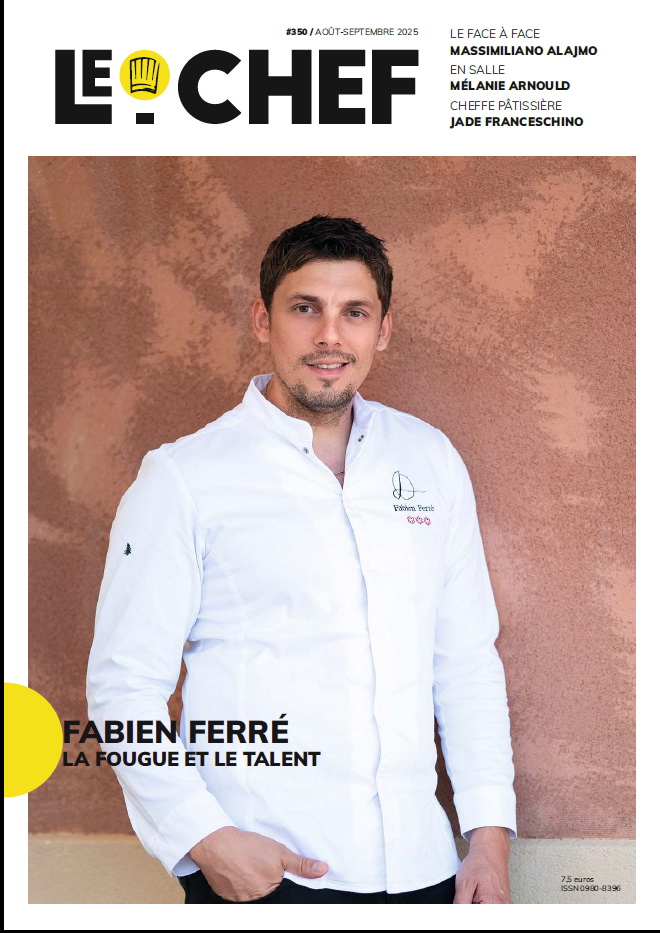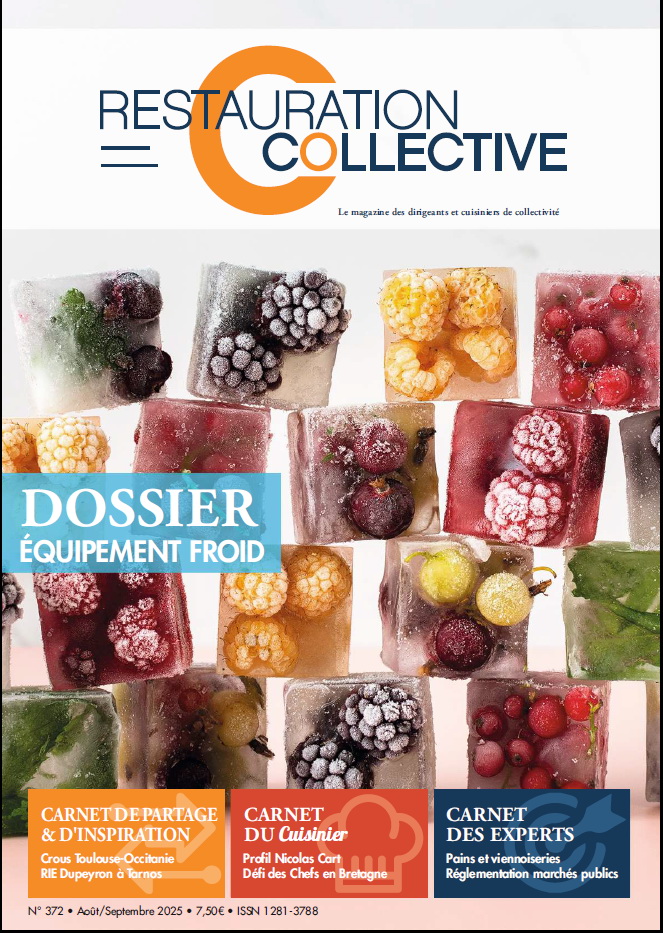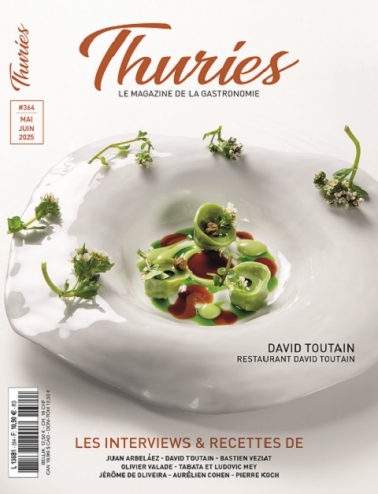![]()
L'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration (Udihr) était une nouvelle fois partenaire d'Hopitech, colloque de l'ingénierie hospitalière qui s'est déroulé cette année à La Baule du 5 au 7 octobre. «La Haute Qualité Environnementale», la «Démarche qualité - réponse aux attentes des patients» et «La massification des achats hospitaliers» étaient les principales thématiques abordées lors des ateliers menés par l'Udihr.
Thierry Lacroix, ingénieur conseil (CSTB), a introduit l'atelier-débat sur la HQE en rappelant l'origine de la Qualité Environnementale. Cette notion est issue des réflexions du Sommet de la Terre en 1992. La démarche HQEÆ répond à deux composantes : le Système de Management Environnemental (SME) et la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB). Ses exigences, selon l'association HQEÆ, s'expriment à travers 14 cibles. La «certification NF bâtiments tertiaires-démarche HQE» est désormais opérationnelle depuis février 2005. Délivrée par le CSTB, elle concerne pour l'instant les bâtiments de bureaux et d'enseignement, de la décision de construction à la livraison, mais devrait par la suite être étendue à l'hôtellerie, au commerce, aux bâtiments de logistique et à la gestion-exploitation. Une vingtaine d'opérations pilotes ont permis d'établir le référentiel. Le collège de Montech, dans le Tarn-et-Garonne, fait partie des premières opérations certifiées.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage en HQE a fait l'objet d'une intervention de Serge Sidoroff, ingénieur conseil (Gestion Conseil Bâtiment). Les tâches de l'AMO HQE durant le programme portent notamment sur la sensibilisation du programmiste, le recueil et l'analyse des contraintes et des besoins, le choix des pistes pertinentes (études de faisabilité), la rédaction des exigences QE. Il participe ensuite à la consultation des entreprises, au suivi des étapes de conception (vérification des objectifs de protection de l'environnement...), à la phase de réception (document de synthèse des caractéristiques environnementales, accompagnement à la mise en service avec mesure des consommations d'eau, d'énergies, etc).
Sylvaine Bouquerel, ingénieur-maître en restauration collective (CHE), a pour sa part fait un point cible par cible sur la relation des bâtiments avec leur environnement, dans le cas d'une application de la HQE en cuisine centrale. Parmi les questions à se poser, pour la cible 1 : La livraison se fait-elle avec des camions bi-température ? La cuisine centrale est-elle intégrée au coeur des résidences ?... La cible 4, qui concerne la gestion de l'énergie, doit inciter à analyser les consommations d'énergie, à installer des capteurs automatiques dans les zones de circulation... La gestion de l'eau (cible 5) peut s'améliorer par la mise en place d'interrupteurs automatiques, de compteurs individuels à l'entrée de la cuisine, etc. La gestion des déchets (cible 6) incite à vérifier s'il y a une politique de recyclage au niveau local, à se conformer à la stricte délimitation des zones propres et sales en cuisine... Concernant la cible 8 et le confort hygrothermique, une étude situe les températures supportables entre 17 et 31°C, mais l'humidité (par exemple en laverie) influe aussi sur la chaleur perçue. La productivité peut être réduite par l'influence hygrothermique. L'inconfort de travail et l'absentéisme ont un coût. Parmi les solutions : installation de «chaussettes», temps de travail rotatif, tenues vestimentaires adaptées...
Le niveau sonore doit aussi être mesuré dans les zones de travail et des ajustements apportés si nécessaire (cible 9, confort acoustique). Disposition des tables dans l'espace, puits de lumière en cuisine ou encore adoucisseurs d'ambiance sont à mettre au compte de la cible 10 (confort visuel).
Gilles Castel, ingénieur conseil (G.SIR), a pour sa part évoqué l'application de la HQE dans la nouvelle UCP de Boulogne-Billancourt (environ 3 000 repas/jour), en fonctionnement depuis septembre dernier. Les pistes retenues ont notamment concerné la récupération d'énergie sur la centrale de froid, la réduction de la consommation énergétique (deux abonnements différents selon kw utilisés), l'intégration d'un condenseur pour pré-chauffer la zone de pré-lavage, la cuisson en enceinte fermée, basse pression (sauteuses, marmites), la gestion avec un logiciel Salamandre pour harmoniser l'élaboration des menus et l'usage du matériel, l'ergonomie des postes de travail (organisation des locaux entre eux, entretien des sols, stockage mobile en chambre froide...).
L'approche HQE a également été présentée au niveau du matériel de laverie. Olivier Robin, de Meïko, tout en soulignant la complémentarité des deux démarches Haccp et HQE, a évoqué le CD-rom lancé il y a six mois, un outil d'aide à la mise en place d'une démarche HQE en laverie. Le confort en laverie doit être à la fois olfactif (débit extracteur, traitement des déchets à distance), hygrométrique (double isolation, extraction d'air à raccordement direct, climatisation), acoustique (double paroi avec isolant) et visuel (hauteur des machines). Les facteurs principaux de l'air ambiant sont une humidité et une température excessives (vaisselle chaude, isolation insuffisante des parois extérieures, etc). L'Air Box intégrée à l'équipement permet d'améliorer le confort hygrothermique et la qualité de l'air, par l'évacuation de l'air vicié et l'arrivée d'air «épuré».
Bénédicte Compère a quant à elle présenté le lave-batterie à granules de Metos. Ces granules en plastique de haute densité attaquent les salissures en évitant le pré-trempage, ce qui permet ensuite un lavage avec moins de produit lessiviel, puis une centrifugation et un rinçage final (séchage rapide). La gestion de l'énergie est également optimisée (récupérateur de chaleur, isolation thermique, condenseur de buées).
Enfin, Claude Peres et Jacques David ont évoqué les matériels de Comenda en laverie, un site sensible synonyme de grosse dépense énergétique et chimique. Le système Ecorinse permet par exemple d'économier l'eau par la récupération de l'eau de rinçage dans une cuve. La gestion de l'énergie peut être optimisée par une pompe à chaleur, un récupérateur de calories, la connexion à un optimiseur, etc. Pour la gestion de l'eau et des détergents : réducteur-régulateur avec manomètre, système précis de contrôle du débit de rinçage (Flux-Control), système Pré-Wash, ajustement du débit de rinçage (PRSÆ), filtration multiple de l'eau des cuves (projet ECO2)...
Jean-Luc Kropfinger, ingénieur et ex-premier président de l'Udihr, s'est pour sa part intéressé à l'impact du choix de la vaisselle (usage unique ou porcelaine) dans un système de restauration hospitalière. Les points positifs de la vaisselle porcelaine sont la convivialité, les habitudes, le maintien au chaud, la notion d'hôtellerie. Parmi les points négatifs : l'hygiène, les qualités de remise en température, le coût en lavage, dressage et remplacement annuel, le poids du plateau, les risques de brûlure, les odeurs fortes à la remise en température... L'usage unique ne permet pas d'emmagasiner les calories, implique de prévoir une surface de stockage suffisante, pose des problèmes de coûts liés aux barquettes, d'élimination des déchets ou encore de communication auprès des patients. Les aspects positifs à souligner sont l'hygiène, le coût de distribution (inférieur à la porcelaine), les charges réduites en lavage, l'automatisation des tâches de conditionnement, la sécurité alimentaire (pasteurisation éventuelle), la précision des grammages, l'adaptation au transport (contenants isothermes), les qualités de conservation...
Il a également parlé du recyclage des barquettes et de la valorisation énergétique (l'incinération des barquettes en polypropylène ou PP ne provoque pas de rejets acides ou de dioxines). Une directive européenne est en cours de préparation afin de déterminer les conditions et autorisations pour utiliser les matières recyclées en contact alimentaire. Il n'existe par ailleurs pas de matériel spécifique (qui serait de préférence automatisé) pour le lavage (obligatoire) et le broyage des barquettes en vue d'être recyclées. Le CH de Roubaix a ainsi fait adapter une machine existante. Il n'y a pas non plus pour l'instant de filière spécifique de recyclage de PP.